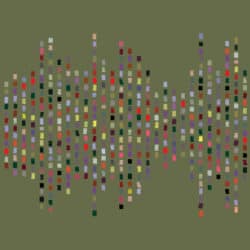Cette contribution s’inscrit dans le cadre du programme Community Harvest de l’organisme The Circle on Philanthropy, une initiative invitant les membres, les partenaires et leurs proches à faire part de leurs réflexions, de leurs apprentissages et de leurs points de vue afin de contribuer à un dialogue permanent et dynamique au sein de notre réseau. Par le biais d’écrits, de poèmes, d’arts visuels, de chansons et d’autres expressions créatives, ce programme consolide le pouvoir de l’expérience commune et de la narration dans la transformation du secteur philanthropique; l’idée est de redistribuer les richesses, d’agir avec sagesse et de renforcer l’infrastructure organisationnelle au service des peuples, des organismes, des communautés et des nations autochtones.
L’article de Rachael Sonola témoigne de l’importance que l’organisme The Circle on Philanthropy accorde à la curiosité. Elle y invite le secteur philanthropique à écouter, à s’adapter et à apprendre en procédant différemment. Elle y soulève des questions pertinentes et met en valeur la sagesse des communautés autochtones qui rendent le secteur plus sage.
Pour en savoir plus sur The Circle, veuillez consulter the-circle.ca.
Le paysage s’étendait devant nous, vaste et immuable, à l’image des histoires qui allaient être racontées. En février 2025, au Kenya, des leaders, des activistes et des conteurs du monde entier ont participé à la 25e conférence mondiale de l’International Funders for Indigenous Peoples (IFIP), sa première réunion sur le continent africain. Leurs propos étaient tous empreints d’une vérité qui exigeait d’être entendue. Parmi les thèmes abordés au cours des conversations, il y en avait un qui résonnait comme un écho : la souveraineté autochtone n’est pas seulement une question de terre ou de gouvernance; il s’agit du pouvoir de décider, de façonner l’avenir et de prospérer comme nous l’entendons.
Définir la véritable autonomisation
Lors de la séance d’ouverture, une femme des hautes terres australiennes a expliqué comment sa communauté avait fait face à des difficultés pendant des décennies, non pas à cause d’un manque de vision, mais d’un manque de confiance de la part des bailleurs de fonds. « Nous n’avons pas besoin de demander la permission de rêver, a-t-elle déclaré. Nous avons besoin de moyens pour réaliser ces rêves. » Ces mots ont résonné fort dans la salle, car pour de nombreuses communautés autochtones, la restriction des financements a longtemps été synonyme de mise en cage plutôt que de liberté.
Un autre leader a fait part d’un témoignage glaçant : son peuple, qui a été déplacé à cause des plantations d’huile de palme, a vu ses terres érodées, ses rivières empoisonnées, et une épidémie de décès maternels emporter ses femmes. Lorsqu’il a demandé des ressources pour pallier ce problème, il s’est heurté à des restrictions, à toutes sortes de formalités sans rapport avec la situation. « Nous n’avons pas besoin de sauveurs, a-t-il déclaré fermement, d’un ton de défi. Nous avons besoin de partenaires. »
Pour bon nombre des personnes présentes à la conférence, tout cela n’est pas nouveau. Elles sont déjà passées par là. Elles ont déjà lutté contre ces mêmes difficultés. Et aujourd’hui, d’une seule voix, elles exigent davantage.
Le lien indéfectible entre le leadership et la justice
Au fil des discussions, une vérité fondamentale s’est imposée : Le leadership autochtone est intersectionnel. Les femmes, les jeunes et les Aînés jouent tous un rôle essentiel dans le maintien des mouvements et des traditions. Mais des obstacles subsistent, en particulier pour les femmes autochtones qui portent le poids de multiples injustices.
La voix pleine de sagesse et de tristesse, une Aînée a évoqué le combat de son peuple. « Nos filles sont les plus désavantagées, a-t-elle déclaré. Elles portent le fardeau de la pauvreté, de la guerre, de l’exclusion. Mais elles sont aussi notre avenir. » Ses propos sont un appel à l’action, qui résonne dans toutes les nations et dans toutes les langues. Les initiatives menées par les autochtones requièrent des investissements, mais pas dans une optique d’assimilation coloniale. Elles doivent être soutenues de manière à respecter leur autonomie, leurs connaissances et leur droit à déterminer leur propre avenir.
Des montagnes de Colombie aux déserts du Kenya, le message est clair : la véritable justice environnementale est indissociable des droits des populations autochtones. Les efforts de conservation qui excluent les communautés autochtones ne constituent pas une solution, mais une nouvelle forme de déplacement.
Des histoires pour guérir, des histoires pour construire
L’un des moments les plus forts de la conférence a été le rassemblement des participants pour un atelier de narration. L’atmosphère était chargée d’émotion alors que les histoires s’entremêlaient, certaines évoquant des générations de douleur, d’autres porteuses d’espoir.
Une femme d’Afrique de l’Est s’est levée pour raconter son parcours, une histoire de survie. Enfant, elle a perdu sa mère lors d’un acte de violence resté impuni. On l’a laissée se débrouiller dans un monde où elle était considérée comme invisible, destinée à être mariée plutôt que scolarisée. Mais elle ne s’est pas laissé faire. Malgré les difficultés, la solitude, le rejet, elle s’est battue. Aujourd’hui, face à nous, cette femme est une leader. « Je distribue des serviettes hygiéniques aux filles de mon village », dit-elle d’une voix inébranlable. Parce que je ne veux pas qu’une autre enfant ait à vivre ce que j’ai vécu. »
Il y a eu un silence dans la salle, puis la force tranquille des hochements de tête en signe de compréhension. C’est pour cette raison qu’un financement sans restriction est si important. Pas seulement pour les politiques, pas seulement pour les projets, mais pour les personnes. Pour des témoignages comme le sien.
Un voyage chez les Masai
Après la conférence, mon voyage m’a conduite dans le comté de Narok, où j’ai rencontré le peuple Masai, un exemple vivant de résilience, de tradition et de transformation. Leur culture dynamique, profondément enracinée dans les savoirs ancestraux, continue de façonner leur identité tout en leur ouvrant de nouvelles perspectives.
Les femmes : gardiennes de la culture et du changement
Les femmes sont la colonne vertébrale de leurs communautés, elles perpétuent les traditions tout en traçant de nouvelles voies pour la génération à venir. Les perlages complexes qu’elles créent témoignent de leur talent artistique; chaque couleur et chaque motif raconte l’histoire d’une identité, d’une situation, d’une tradition. Mais au-delà de leur savoir-faire, ces femmes sont des figures de proue du développement communautaire, à la tête de coopératives qui commercialisent leurs produits artisanaux sur les marchés mondiaux, soutiennent leurs familles et préservent leur patrimoine.

Malgré certaines difficultés comme le mariage précoce et l’accès limité à l’éducation, de nombreuses femmes masai arrivent à surmonter les obstacles. Elles suivent des études, se lancent dans l’entrepreneuriat et assument des fonctions de direction, prouvant ainsi que la culture et le progrès peuvent aller de pair. Leur résilience et leur détermination ont été à la fois une source d’inspiration et une leçon d’humilité, la preuve que la véritable autonomisation commence au sein même de la communauté.
Les guerriers et la danse de la force
Pour les hommes masai, le parcours pour devenir guerrier (moran) est synonyme d’endurance et de discipline et revêt une grande importance culturelle. Dès leur plus jeune âge, ils sont soumis à des rites de passage qui les préparent à diriger, à dresser des troupeaux, à survivre et à protéger leur communauté.
L’une des traditions les plus captivantes dont j’ai été témoin est l’adumu, la célèbre « danse du saut » exécutée lors de la cérémonie Eunoto. Lors de cette cérémonie, les jeunes guerriers se rassemblent en cercle et entonnent des chants rythmés. L’un après l’autre, ils s’élancent dans les airs, sautant aussi haut qu’ils le peuvent sans plier les genoux, symbole de leur vitalité, de leur force et de leur volonté de diriger. Plus ils sautent haut, plus ils impressionnent leurs pairs et les Aînés, gagnant ainsi respect et admiration.
Drapés dans leurs shúkàs rouges caractéristiques et ornés de perles complexes, les guerriers masai se déplacent avec grâce et assurance, incarnant la résilience de leur peuple. L’énergie qui régnait dans l’air était électrique, preuve du pouvoir durable de la tradition dans la formation de l’identité et des liens communautaires.

Honorer le passé, accueillir l’avenir
Cette visite à la communauté autochtone masai m’a vivement rappelé que la tradition n’est pas un obstacle au progrès; au contraire, elle constitue le fondement sur lequel les communautés bâtissent leur avenir. Les Masai continuent d’honorer leur passé tout en ouvrant de nouvelles perspectives, ce qui leur permet de préserver leur riche patrimoine culturel pour les générations à venir.
En quittant le comté de Narok, j’ai emporté avec moi non seulement des souvenirs de leurs traditions, mais aussi une leçon de résilience, de fierté et un enseignement sur l’importance de la préservation de la culture. Le peuple masai se tient debout, tout comme les guerriers qui sautent pour garder le ciel, nous rappelant que la force se trouve dans l’identité et que l’avenir est façonné par les gens qui chérissent leur passé.
Des voix autochtones pour façonner l’avenir
Au terme de la conférence, une chose était claire : les populations autochtones ne demandent pas la charité. Elles demandent justice. Elles plaident pour un monde où le financement n’est pas un don, mais une reconnaissance de leurs droits. Un monde où les ressources sont mises à la disposition des communautés sans être assorties de conditions qui les privent de leur pouvoir. Un monde où elles ont leur mot à dire.
Comme l’a si bien dit l’une des personnes participantes :« Lorsque vous investissez dans les populations autochtones, vous ne financez pas seulement un projet, vous financez des générations. »
Cette rencontre a été plus qu’une simple conférence. Ce fut une prise de conscience. Un rappel que les solutions les plus puissantes viendront toujours des personnes qui les vivent. Et lorsque les délégations ont quitté la salle, le vent portait leurs mots, leurs revendications, leurs rêves, tissés ensemble, indissolubles, inarrêtables.
Rachael Sonola est une professionnelle nigériane canadienne de la communication stratégique qui utilise la narration pour mobiliser le public et exercer une influence sur le secteur philanthropique.