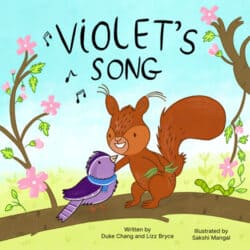Une campagne de sensibilisation d’Action Canada lutte contre la polarisation et la mésinformation en faisant appel au contact humain et à l’empathie, et en incitant les gens à avoir des conversations dans la vie réelle avec des personnes de leur entourage. Cet article explique comment l’organisme a réalisé son objectif, de la conception à l’élaboration de la stratégie, en passant par la direction artistique et la mise en œuvre.
Partout au Canada et dans le monde, les politicien·nes et les mouvements anti-droits s’efforcent de semer la division et de creuser le fossé entre la « gauche » et la « droite ». Le droit à l’autonomie corporelle et à l’éducation a été détourné pour livrer des batailles politiques polarisantes au cœur desquelles l’avortement, les droits des jeunes queers et transgenres et l’éducation sexuelle sont utilisés pour susciter la peur chez les Canadien·nes ordinaires. En tant que professionnelle de la communication à but non lucratif et alliée de la justice reproductive, je ne sais que trop bien comment ce contexte politique a alimenté les commentaires haineux et renforcé les chambres d’écho en ligne et en personne.
Cependant, au début de l’année 2024, mes collègues d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels ont eu l’occasion de concevoir une campagne visant à refaçonner le discours et à mettre de nouveau l’accent sur l’empathie, l’établissement de liens et la communauté. Plutôt que de laisser les attaques croissantes contre la santé et les droits sexuels et reproductifs nous diviser encore plus, nous avons adopté le changement de discours comme cadre pour souligner nos valeurs communes, trouver un écho auprès de nouveaux publics et nous sortir du désespoir existentiel.
Le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces (avec l’Alberta et la Saskatchewan) où les approches du gouvernement sur ces questions ont alimenté la désinformation sur les droits sexuels et reproductifs. Il s’agit notamment de directives et de politiques qui ont entraîné la fermeture de cliniques d’avortement communautaires et l’élimination de mesures de protection pour les jeunes transgenres et diversifié·es sur le plan du genre dans les salles de classe. (En octobre, les Néo-Brunswickois·es ont élu un nouveau gouvernement, qui a rétabli certaines mesures de protection pour les soins de santé liés à la reproduction et les jeunes transgenres dans les écoles.)
Au printemps 2024, nous avons choisi le Nouveau-Brunswick comme première région pour mettre à l’essai le changement de discours en tant que cadre de lutte contre la désinformation, l’autoritarisme et la polarisation. Avec l’objectif ambitieux de toucher l’ensemble des Néo-Brunswickois·es, nous espérions créer des histoires captivantes qui inciteraient les gens à se déconnecter et à tenir des conversations dans la vie réelle avec les personnes de leur entourage.
Voici comment nous avons réalisé notre objectif.
Tirer parti de l’occasion : nous réapproprier nos communautés
Dotés d’un budget modeste, nous nous sommes associés à Principles, une agence de marketing fondée sur les valeurs pour nous orienter dans la découverte, la stratégie, la direction créative et la mise en œuvre.
Le processus de découverte robuste comprenait des études de marché, des analyses de l’environnement, des entretiens avec les parties prenantes, des groupes de discussion, des sondages nationaux et locaux, ainsi qu’un examen approfondi des tactiques de changement de discours que les intervenant·es anti-droits utilisent avec succès depuis des années. En termes simples, nous étions à la recherche d’histoires. Quelles histoires sont racontées dans tout l’éventail politique, ou celles que les gens racontent à propos d’eux-mêmes et de leurs communautés? Quelles histoires sont perdues lorsque règne la division? Et quelles histoires pourrions-nous raconter pour réécrire les discours nuisibles?
Les résultats de l’enquête ont mis en évidence le fait que les opinions et les croyances des gens sur des questions épineuses (comme l’avortement, l’éducation sexuelle et les droits des personnes transgenres) sont guidées par l’émotion plutôt que par des renseignements exacts. Une personne participant à l’enquête a noté que les gens « ne semblent pas se soucier des données si elles ne correspondent pas à leurs sentiments. » Cette observation est corroborée par une série de recherches menées dans différentes disciplines, notamment la neuroscience et la psychologie. Nous ressentons d’abord et pensons ensuite, ce qui nous permet de nous forger des opinions et des croyances souvent liées à notre perception de nous-mêmes (essentiellement, un biais de confirmation).
Lorsque des renseignements haineux et inexacts circulent en ligne, ils exploitent les incertitudes et les craintes des personnes concernant le monde et la place qu’elles y occupent. Ils renforcent les discours qui s’inscrivent dans les préjugés, les croyances et même le sentiment d’identité. Les algorithmes des médias sociaux exacerbent ce phénomène, et l’évolution des plateformes comme X et Meta rend les choses encore plus extrêmes.
Nos stratèges ont constaté « qu’il existe des preuves substantielles selon lesquelles les plateformes de médias sociaux sont susceptibles de récompenser et d’amplifier les contenus scandaleux, provocateurs ou choquants par rapport aux données et aux faits ennuyeux, en raison des algorithmes et des systèmes de récompense axés sur l’engagement. »
Nous avons également observé que « les interactions incendiaires sur les médias sociaux sont souvent incompatibles avec la façon dont nous existons dans les communautés hors ligne. » Les personnes qui, en ligne, se perçoivent comme des adversaires politiques peuvent être des voisins sympathiques, d’anciens camarades de classe ou même des membres de la famille.« Sur Internet, les gens sont prêts à se disputer anonymement avec n’importe qui », déclare une personne participant à l’enquête. « Et cette personne est probablement la commis du magasin avec laquelle ils entretiennent de bonnes relations. »
Lorsque nous entrons en interaction dans la vie réelle, il est plus facile d’établir des liens émotionnels qui peuvent remettre en question nos hypothèses sur le monde.
Lorsqu’on nous incite à nous disputer en ligne, nous perdons de vue les expériences et les valeurs que nous partageons. Les divisions s’accentuent, même lorsque nous partageons des difficultés aussi simples que de trouver un médecin de famille ou de faire face au coût de l’épicerie. Dans les communautés réelles au sein desquelles nous vivons, y compris notre foyer, notre quartier, notre club de curling ou de jardinage, notre ville, ou les communautés provinciales et nationales plus larges, les plateformes virtuelles ne permettent pas de renforcer le sentiment du « nous ».
Au mieux, ces plateformes établissent des liens dans les communautés et démocratisent l’information. Mais dans le pire des cas, les plateformes de médias sociaux détournent nos relations, les histoires liées aux communautés dans lesquelles nous vivons, et les personnes avec lesquelles nous vivons en communauté.
C’est là qu’est née l’étincelle : lorsque nous entrons en interaction dans la vie réelle, il est plus facile d’établir des liens émotionnels qui peuvent remettre en question nos hypothèses sur le monde. Nous devions inciter les gens à mettre l’écran de côté et à commencer à se parler.
Prospection approfondie : la famille et les amis d’abord
Cependant, parler aux gens est effrayant lorsqu’il n’y a pas d’écran derrière lequel se cacher ni bouton de blocage sur lequel cliquer si les choses se gâtent. Et si les croyances des gens sont si profondément ancrées, est-il possible de s’en affranchir? La solution était la prospection approfondie.
Il s’agit d’une technique utilisée dans l’organisation communautaire et l’activisme qui consiste à tenir des conversations prolongées et approfondies avec des personnes afin de comprendre leurs points de vue et de les persuader de soutenir une cause ou un point de vue particulier. Contrairement à la prospection traditionnelle, qui met souvent l’accent sur la diffusion d’un message scénarisé ou sur la collecte de réponses rapides, la prospection approfondie donne la priorité à l’établissement de liens authentiques et à l’empathie.
Selon le Deep Canvass Institute, la prospection approfondie est une conversation à double sens au cours de laquelle l’enquêteur sollicite sans jugement l’opinion de l’autre personne sur un sujet et pose des questions complémentaires afin de mieux comprendre son point de vue. Il est essentiel de partager des histoires sur les expériences personnelles liées à cette question, afin de trouver des valeurs communes et d’aider l’autre personne à acquérir une nouvelle compréhension du sujet. Une étude de cas sur la prospection approfondie aux États-Unis a montré que même « des conversations de 15 minutes peuvent créer des changements considérables qui sont extrêmement durables. »
« La prospection approfondie est puissante, car elle permet de réorienter la discussion en mettant l’accent sur la communication plutôt que sur la persuasion », explique Zach Zimmel, cofondateur de Principles. « Elle nous apprend à écouter et à créer des moments où la personne se sent suffisamment en sécurité pour réfléchir à ses croyances et se demander si toutes ses croyances sont liées à ses valeurs humaines fondamentales. Lorsque nous utilisons cette approche, nous n’essayons pas seulement de changer les opinions. Nous instaurons la confiance, qui est le fondement de tout changement de discours notable. Nous devons également aborder ces conversations avec un esprit suffisamment ouvert pour réaliser que nous pouvons, nous aussi, nous tromper sur certains points. »
La prospection approfondie est puissante, car elle permet de réorienter la discussion en mettant l’accent sur la communication plutôt que sur la persuasion.
Zach Zimmel, Principles agence de marketing
En tant que tactique éprouvée, la prospection approfondie est un moyen indéniable de sortir des chambres d’écho numériques et des algorithmes axés sur les conflits pour amorcer le dialogue dans la vie réelle. Mais nous devions réduire l’échelle : les conversations difficiles ne devaient pas avoir lieu entre des étrangers faisant du porte-à-porte, mais entre des amis ou des membres de la famille. L’objectif n’était pas de les convaincre ou de les persuader, mais d’instaurer une confiance mutuelle, de trouver un terrain d’entente et – peut-être – d’établir une curiosité et une réflexion de bonne foi sur le contenu en ligne que nous consommons et partageons tous.
Le plus grand rêve de notre équipe aurait été de faire changer d’avis des personnes ouvertement hostiles à des questions comme les droits des personnes transgenres et l’éducation sexuelle, mais nous savions aussi que nous n’avions ni le temps, ni les ressources, ni l’audace pour y parvenir. Au lieu de cela, nous espérions inciter à la réflexion les gens ignorants ou mal informés, mais prêts à dialoguer ouvertement sur leur point de vue. Nous ne nous adressions pas aux personnes alliées, mais à celles qui pourraient le devenir ou se laisser persuader; représentant 60 % de la population, on appelle souvent ces personnes « la moyenne ».
Au lieu d’argumenter dans les sections des commentaires des médias sociaux ou de bloquer des personnes en ligne, nous avons demandé à nos allié·es d’avoir ces conversations difficiles dans la vie réelle. En remplaçant les cycles de pièges à clics par de véritables contacts humains, notre public servirait d’ambassadeur·rices dans leurs communautés.
Outils de campagne : le pouvoir de l’accroche narrative
Nous avons trouvé un titre reproductible, concis et efficace qui serait mémorable et accessible au public : Déconnectons et parlons. Et pour inspirer le public et lui donner les moyens d’amorcer ces conversations hors ligne, nous devions ancrer la campagne dans des histoires fortes auxquelles il est possible de s’identifier.

Lorsque nous avons contacté OPC Films pour créer des vidéos pour la campagne, nous sommes arrivés avec notre modeste budget et notre histoire, une histoire qui cherchait à rassembler les communautés et à lutter contre la polarisation politique.
Il s’est avéré que l’idée même de cette campagne a suscité de l’espoir. L’équipe d’OPC et le groupe qu’elle a établi ont été tellement enthousiasmés par ce que nous essayions de faire qu’ils ont consacré une quantité incroyable de temps et de ressources pour donner vie aux histoires. Sans leur confiance et leur générosité, nous n’aurions jamais pu faire appel à des talents de ce niveau. Le metteur en scène Paul Shkordoff a créé un monde chaleureux, honnête et intime dans lequel nous pouvions demander aux publics de se voir en train d’avoir leurs propres conversations vulnérables.

En réunissant nos trois équipes artistiques (Action Canada, Principles et OPC), nous avons créé deux histoires pour nous aider à remettre l’accent sur l’empathie dans les récits sur les droits des jeunes transgenres et l’éducation sexuelle.
La première histoire met en scène Dave et Greg, deux frères dont la relation étroite devient tendue lorsque Greg publie en ligne des propos blessants sur les enfants transgenres. Sammy, l’enfant à l’âge de l’adolescence de Dave, est une personne transgenre. Plutôt que de laisser les actions de Greg creuser un fossé entre eux, Dave va parler à son frère de la façon dont ses messages ont blessé Sammy et lui.
La deuxième histoire porte sur Ashley qui consulte son amie Maggie, afin de savoir comment parler à sa mère à propos de quelque chose que celle-ci a publié en ligne. Malgré leurs différences, Ashley parvient à amener sa mère à s’ouvrir et à parler du problème. Bien que nous ayons toujours eu l’intention d’axer cette histoire sur l’éducation sexuelle, nous avons intentionnellement laissé le scénario vague. Nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons : pour éviter la censure sur les plateformes publicitaires, pour permettre au public de voir dans l’histoire un sujet qui lui tient à cœur et pour faire passer le message de « se déconnecter et parler » au public sans susciter de réaction automatique par rapport à l’éducation sexuelle.
Ces deux courts-métrages servent à la fois de modèles du déroulement possible de ces conversations et d’outils pour humaniser les relations qui sont affectées lorsque nous publions des choses polarisantes en ligne. Ces récits mettent également l’accent sur le rôle du parent, font preuve d’empathie à l’égard des personnes qui ont pu causer du tort et modélisent la façon dont les conversations peuvent se dérouler. Ils démontrent le pouvoir, la vulnérabilité et les possibilités qui s’ouvrent à nous lorsque nous essayons d’établir ces liens dans la vie réelle. Fondamentalement, les personnages de ces histoires s’aiment, malgré le mal qu’ils se font. Et le moment où ils essaient de se comprendre mutuellement permet une véritable guérison, même pour le public qui regarde la scène.
Ces sentiments de confiance, d’amour et d’empathie ont été essentiels à la réalisation de cette campagne. Les faits sont importants – et nous avons inclus des renseignements précis sur l’éducation sexuelle et les droits des personnes queers et transgenres sur le microsite de la campagne. Toutefois, c’est la mise en avant de nos valeurs communes et la narration d’histoires émotionnelles qui ont le potentiel de briser les barrières et d’avoir un réel impact. C’est ce que font continuellement les mouvements anti-droits, en cherchant à semer la peur, l’incertitude, la colère et la haine. Déconnectons et parlons fait plutôt appel à l’empathie, à la confiance, à la curiosité et à l’humanité. La campagne rappelle que nous vivons en communauté les uns avec les autres, même lorsque les médias sociaux essaient de nous diviser.
Lancement, suivi, adaptation et réactions
Évidemment, les plateformes de médias sociaux ne sont pas exactement optimisées pour les campagnes visant à lutter contre la mésinformation sur les questions liées au genre et à la santé sexuelle. Au cours de la semaine de lancement, YouTube a rejeté nos publicités vidéo sur la base du fait qu’elles enfreignaient la politique relative à l’orientation sexuelle dans la publicité personnalisée. Après un appel infructueux, nos stratèges ont téléchargé à nouveau les vidéos publicitaires en tant que « non répertoriées », en supprimant tout contenu écrit qui pourrait être interprété comme portant sur l’orientation sexuelle dans les titres et les descriptions des vidéos. Après ces modifications, la publicité sur YouTube s’est déroulée sans problème.
La partie publicitaire de la campagne s’est déroulée du 4 au 30 septembre, coïncidant avec la rentrée scolaire et – malheureusement – avec l’envoi par la poste de 160 000 dépliants anti-trans dans tout le Nouveau-Brunswick par un groupe national de lutte contre l’avortement. Les dépliants contenaient des renseignements erronés et dangereux, fondés sur un discours alarmiste. C’est à ce type d’efforts coordonnés et bien financés que sont confrontés les organismes progressistes. Et ce sont précisément ces perspectives que nous espérons réorienter dans les communautés.
Les dépliants ont été distribués quelques jours avant le lancement de notre campagne. Nous n’avions ni l’argent, ni le temps, ni les ressources nécessaires pour riposter avec nos propres dépliants. Nous devions avoir confiance dans le fait que nos publicités numériques et nos annonces à la radio locale toucheraient les gens, et ce, sur les appareils mêmes que nous les encouragions à mettre de côté. Et nous pouvons affirmer avec confiance que de nombreux ses Néo-Brunswickois es ont au moins vu notre campagne. Rien que sur Facebook et Instagram, nous avons atteint un·e Néo-Brunswickois·e sur trois et généré plus de trois millions d’affichages.
Au-delà des simples chiffres, nous avons également entendu des histoires et des réactions du Nouveau-Brunswick et d’autres régions du Canada à l’égard de l’initiative Déconnectons et parlons : « J’en ai eu les larmes aux yeux. Ce message est d’une importance essentielle. » « La recommandation “de déconnecter et de parler” est valable pour TOUS les sujets difficiles de la vie. Montrez l’exemple avec amour. Écoutez. Parlez de personnes réelles, pas de questions abstraites. » « J’adore ça. Les conversations face à face sont difficiles, mais très efficaces. »
David-Roger Gagnon est ministre de la United Church dans une église affirmative (pro-2ELGBTQIA+) au Nouveau-Brunswick. Il s’est fait le défenseur de la sécurité et de l’inclusion des personnes membres de la communauté 2ELGBTQIA+ dans les communautés religieuses et a publiquement condamné l’envoi massif de dépliants anti-trans en septembre.
Il est difficile d’attirer l’attention du public sur des messages véhiculant des conversations et des dialogues calmes. Cette campagne s’inscrit parfaitement dans le cadre de mon message sur la recherche de la sagesse en ces temps tumultueux.
David-Roger Gagnon, ministre de la United Church
Quelques jours après le lancement de l’initiative Déconnectons, M. Gagnon a communiqué avec notre équipe pour demander la permission de diffuser les vidéos de la campagne auprès de sa congrégation. J’ai répondu à sa demande. « Il est difficile d’attirer l’attention du public sur des messages véhiculant des conversations et des dialogues calmes », a-t-il déclaré. « Cette campagne s’inscrit parfaitement dans le cadre de mon message sur la recherche de la sagesse en ces temps tumultueux. Les vidéos que nous avons diffusées pendant notre cérémonie religieuse ont été extrêmement bien accueillies. Les gens ont aimé le ton et l’approche. Je crois que cette campagne peut sauver des vies. »
La réponse a été claire : pour tant de gens qui sont fatigués, dépassés et qui perdent espoir dans un paysage politique polarisé, l’initiative Déconnectons et parlons a rappelé que l’empathie et l’établissement de liens sont une stratégie gagnante.
Apprentissages, localité et prochaines étapes
Pour plusieurs d’entre nous, cette campagne a été un exercice d’introspection sur nos relations et notre activisme. « Ce projet m’a fait réfléchir à mon activisme au fil des années et aux nombreuses fois où j’ai établi des barrières très strictes avec des personnes avec lesquelles je n’étais pas en accord sur les questions qui me passionnaient », explique Zach Zimmel. « Avec le temps, cela signifie que j’ai créé une petite communauté insulaire qui est en accord avec moi. Cette communauté n’est pas assez importante pour mettre en œuvre les changements révolutionnaires que je souhaite voir s’opérer dans le monde. Je me rends donc compte qu’il est temps d’écouter pour comprendre plutôt que d’écouter pour gagner. Et cette évolution des cœurs et des esprits est un véritable jeu de longue haleine qui commence par la recherche de points communs et de valeurs partagées. Ceux-ci ne sont pas aussi difficiles à trouver qu’on pourrait le croire, à condition de les chercher. »
Tout au long de l’élaboration et du lancement de la campagne, nous avons communiqué avec des allié·es au Nouveau-Brunswick, dont beaucoup dirigent des organismes de première ligne et de défense des droits. En tant qu’organisme national se lançant dans une campagne régionale, nous nous sommes appuyés sur leur expertise locale, leurs idées et leurs commentaires pour faire en sorte que la campagne trouve un écho auprès des Néo-Brunswickois·es. Ces collaborations ont contribué à ancrer notre équipe dans l’éthique de Déconnectons et parlons. Action Canada travaille à l’échelle canadienne, mais cette campagne a souligné l’importance des localités et des relations en personne. Nous ne sommes pas que des valeurs numériques, mais sommes façonnés par les communautés de la vie réelle au sein desquelles nous vivons.
Je me rends donc compte qu’il est temps d’écouter pour comprendre plutôt que d’écouter pour gagner. Et cette évolution des cœurs et des esprits est un véritable jeu de longue haleine qui commence par la recherche de points communs et de valeurs partagées.
Zach Zimmel
Étant moi-même originaire des Maritimes, j’ai été ravie d’avoir l’occasion de collaborer et de mettre en lumière le travail extraordinaire réalisé sur la côte est. Je me suis donc rendue à Moncton pour rencontrer un groupe d’organismes travaillant sur les questions des droits de la personne dans la région. La majeure partie de nos activités a lieu en ligne au moyen de courriels, de réunions Zoom et de messages texte, mais ce sont ces moments relationnels qui ont donné vie à mes sentiments de motivation et d’espoir.
Je suis bien consciente de l’ironie et des limites d’une campagne de publicité numérique visant à inciter les gens à délaisser les écrans, et des personnes qui n’ont pas pu être jointes en raison du caractère exclusivement en ligne de la campagne. Nous avons passé quelques publicités limitées sur la radio locale, mais aurions aimé avoir les fonds nécessaires pour faire des envois postaux ou de la publicité extérieure (panneaux d’affichage, annonces sur les autobus, etc.), et collaborer avec des organismes locaux pour organiser des séances de discussion ouverte.
Alors que nous vivons un cycle d’élections incessant et la polarisation qui l’accompagne, des campagnes comme Déconnectons et parlons montrent comment nous pouvons trouver un terrain d’entente, même lorsque la situation nous met mal à l’aise.
Cette campagne ne visait pas à donner raison aux progressistes, mais à démanteler la polarisation qui sépare des personnes qui, en fin de compte, se soucient les unes des autres. Quelles que soient notre origine ou notre identité, nous nous soucions tous du bien-être de nos familles et de nos communautés.
Les organismes féministes et progressistes tombent souvent dans les pièges de la perfection et des politiques moralisatrices – comment pourrions-nous avoir tort si nous luttons pour des valeurs comme l’autonomie corporelle, l’équité et un meilleur avenir pour tous? Comment une campagne pourrait-elle être efficace si elle ne s’inscrit pas parfaitement dans les valeurs féministes? Cependant, ces attitudes ne font que creuser le fossé qui nous sépare, aliéner nos voisins et freiner notre mouvement.
Au-delà de l’indignation et de l’appât de la rage encouragés par les plateformes sociales et les politiciens, nous avons plus de choses en commun dans nos communautés de la vie réelle que nous ne le pensons. Nous sommes liés par des valeurs communes : nous voulons tous moins d’embouteillages dans les villes, des logements abordables pour les familles, une épicerie abordable, des écoles sûres et l’accès aux soins de santé.
Ces valeurs sont plus évidentes lorsque nous nous présentons en personne, dans toute notre humanité, avec l’empathie au premier plan. C’est la base dont nous avons besoin pour changer le discours et, en fin de compte, améliorer la réalité matérielle de chacun d’entre nous. Un avenir où nous aurons tous accès aux ressources dont nous avons besoin pour favoriser l’épanouissement des familles et des communautés, y compris la sécurité des jeunes queers et transgenres et l’accès à une éducation sexuelle complète.
Nous espérons que l’initiative Déconnectons et parlons pourra servir de modèle à d’autres organismes désireux d’amorcer un nouveau discours pour un avenir meilleur!
Avec une profonde gratitude envers Jill Oba-McGrath et Frédérique Chabot d’Action Canada, Zach Zimmel et l’équipe de Principles, Paul Shkordoff, Emily Harris, Harland Weiss et l’équipe d’OPC Films, Alter Acadie, Chroma NB et les autres partenaires participants au Nouveau-Brunswick, ainsi que David-Roger Gagnon.
Ressources pour l’élaboration de messages et de campagnes de changement de discours (en anglais seulement) :
- ASO Communications
- Narrative Initiative
- Antidote to Authoritarianism de la People Action’s Institute
- Funding Narrative Change: An Assessment and Framework du Convergence Partnership
- Social Change Initiative
- Commons Social Change Library
- Reframing Migration Narratives Toolkit de l’International Centre for Policy Advocacy
- Reframe Academy